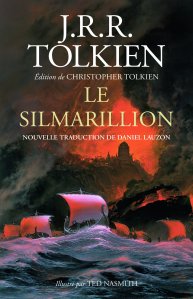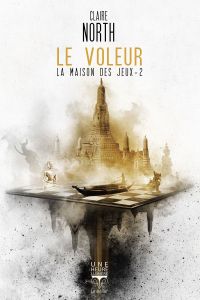Salutations !
Un peu tardivement ce dimanche, voici le rendez-vous Premières lignes. J’ai opté pour un classique de la fantasy que je n’ai pas encore eu l’occasion de découvrir : Terremer d’Ursula Le Guin.
Belle fin de week-end à vous.
Le principe : chaque semaine, je prends un livre et je vous en cite les premières lignes du récit. Pensez à mettre le lien de votre RDV en commentaire de l’article ou, si vous avez une page ou une catégorie dédiée, n’hésitez pas à me le faire savoir ; cela facilitera l’actualisation.
N’oubliez pas de me citer, ça fait toujours plaisir ♡
1
Les guerriers dans la brume
L’île de Gont, formée d’une seule montagne qui se dresse à cinq mille pieds au-dessus des flots tumultueux de la mer du Nord-Est, est une terre renommée pour ses magiciens. Bien des hommes de Gont ont quitté les bourgades de ses hautes vallées, et les ports de ses sombres baies encaissées, pour s’en aller servir les Seigneurs de l’Archipel dans leurs cités, comme sorciers ou comme mages ; d’autres, préférant l’aventure, sont partis voguer d’île en île, pratiquant leur magie d’un bout à l’autre de Terremer.
Certains disent que parmi eux, le plus grand, et sans nul doute le plus intrépide voyageur, fut celui qu’on appelait Épervier, et qui fut en son temps à la fois Seigneur des Dragons et Archimage. Sa vie est contée dans la Geste de Ged et dans bien des chansons, mais ceci est une histoire d’avant sa renommée, avant que les chansons n’aient été écrites.
Il naquit dans un village appelé Dix-Aulnes, perché dans la montagne à l’embouchure du Val du Nord, dont les pâturages et les champs descendent en paliers vers la mer. D’autres bourgades sont nichées dans les méandres de la rivière Ar, mais au-dessus du village lui-même, il n’y a que des forêts qui couvrent crête après crête, jusqu’aux roches nues et aux étendues neigeuses des hauteurs.
Le nom qu’il porta durant son enfance, Duny, lui avait été donné par sa mère, et ce nom ainsi que sa vie furent tout ce qu’elle put lui offrir, car elle mourut avant qu’il n’ait atteint l’âge d’un an. Son père, le fondeur de bronze du village, était un homme sévère et taciturne ; et comme les six frères de Duny, bien plus âgés que lui, avaient l’un après l’autre quitté la demeure familiale pour cultiver la terre, sillonner les mers ou travailler à la forge dans les autres villages du Val, il ne se trouva personne pour élever l’enfant dans la tendresse. Il poussa comme la mauvaise herbe, et devint un grand et fier garçon, au parler fort, au caractère vif et ombrageux. En compagnie des quelques enfants que comptait le village, il commença par garder les chèvres sur les prairies pentues, au-dessus des sources ; puis, lorsqu’il fut suffisamment fort pour actionner les grands soufflets de la forge, son père le prit comme apprenti, à grands renforts de taloches et de coups de martinet. Il n’y avait pas grand-chose à tirer de Duny. Il était toujours par monts et par vaux, s’aventurant au plus profond de la forêt ou nageant dans les bassins de l’Ar qui, comme toutes les rivières de Gont, était rapide et glacée. Ou bien encore il escaladait les falaises et les escarpements pour atteindre, au-dessus de la forêt, un endroit d’où il pouvait apercevoir la mer, ce vaste océan nordique où, passé Perregal, on ne trouve plus aucune île.
L’une des sœurs de sa mère disparue habitait au village. Elle avait pris soin de lui lorsqu’il était bébé, mais elle avait ses propres occupations, et ne lui avait plus prêté attention dès lors qu’il avait pu se débrouiller seul. Mais un jour, ce gamin de sept ans, sans instruction et ignorant tout des arts et des pouvoirs qui règnent sur le monde, entendit sa tante crier quelques mots à une chèvre qui avait sauté sur le chaume d’une hutte et qui refusait d’en bouger – mais elle était bien vite redescendue quand la tante avait prononcé une certaine phrase. Le lendemain, alors qu’il menait ses chèvres à poils longs sur les pâturages de la Grande Chute, Duny leur cria les mots qu’il avait entendus, sans en connaître l’utilité ni le sens, ni même la nature :
Nor esse ma lom
Hiolk han mer hon !
Il cria ce couplet d’une voix forte, et les chèvres vinrent à lui. Elles vinrent rapidement, groupées et en silence, et le fixèrent de la prunelle sombre de leurs yeux jaunes.
Terremer, intégrale, Ursula K. Le Guin, 1977.

Terremer, intégrale
Les blogueurs et blogueuses qui y participent aussi :